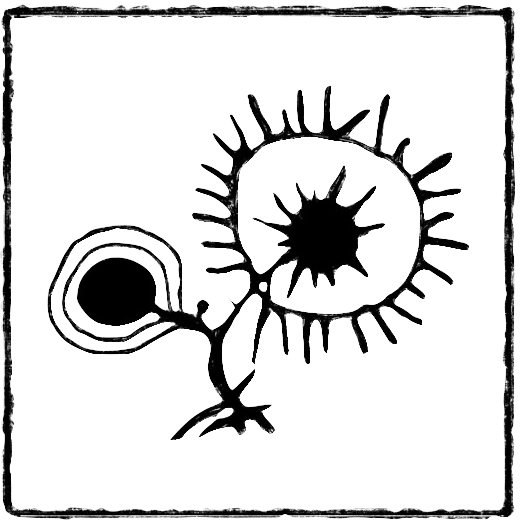Jusqu’au 18 mai, au 3T, Floriane Comméléran met en scène Vieille Petite Fille de Juliette Riedler paru aux éditions Tango Girafe. Juliette Séjourné y incarne le rôle principal. Elle a également donné voix aux Lettres à Jean-Rivière dans le cadre d’un dispositif d’écoute présenté dans le hall du théâtre. Si ces deux textes d’un désormais livre sont réunis et présentés complémentairement dans ces lieux, d’autres formes ont existé, d’autres modalités scéniques et dramaturgiques : des textes en circulation, dont se saisissent et dessaisissent les artistes au gré d’un débordement de l’objet éditorial et dans une plasticité vivante de l’écriture.
⠀
Rodolphe : Si Vieille Petite Fille et les Lettres à Jean-Loup Rivière sont deux textes de Juliette Riedler désormais édités aux éditions Tango Girafe, leur vie déborde le cadre éditorial. Ils sont présentés dans un dispositif particulier au mois de mai au 3T dont on pourrait peut-être parler pour ouvrir cet échange.
Juliette R.: Ce sont deux textes écrits dans deux contextes différents. Le premier dans l’ordre de l’écriture, Lettres à Jean-Loup Rivière, est né d’une nécessité extrême au moment de la mort de mon directeur de thèse, de m’adresser à lui pour comprendre ce que je pouvais faire de moi-même dans le grand désarroi où je me trouvais (abandonnée). Continuer à écrire et poursuivre le travail entamé revenait à continuer à vivre, oser mener l’écriture et le sujet à ma façon. C’est mon premier texte et il y est d’emblée et de manière absolument radicale, question d’émancipation. L’écriture est un fil tendu entre la mort et la vie. Comme une manière de tester ses pouvoirs. S’émanciper de la prise de la mort en soi, de sa morsure, de ses sirènes, pour continuer à vivre non pas sous sa menace mais en ayant intégré sa potentialité comme une urgence à être, à vivre, à créer.
C’est cela que je reprends dans Vieille Petite Fille, où la question de l’émancipation se rejoue au sein du conte du Petit Chaperon Rouge dans la version qu’en donne Charles Perrault. Vieille Petite Fille est née d’une commande d’écriture de la part du Festival Lyncéus, à Binic-Étables-sur-mer, pour ce territoire d’où provient ma famille maternelle. Le thème donné était « Sauvage », et je sentais bien qu’il y avait quelque chose à tisser entre ce conte bien connu, qui ne cessait de revenir dans mes rêves, et la question de la sauvagerie, qu’elle soit associée à la maternité ou au désir masculin. Le conte présente un double risque de mort pour une fille, dont il chiffre la liberté dans ce monde : entre le risque et donc la peur de reproduire une fatalité matrilinéaire, ce qui se transmet « de l’intérieur », et la peur du loup, « de l’extérieur », et les risques que peuvent comporter la séduction masculine. Ce sont à ces risques que j’ai eu envie de me confronter dans et par l’écriture.
Rodolphe : La question de l’émancipation est au cœur de ton travail de recherche, Juliette, mais aussi dans vos pratiques et réflexions Juliette et Floriane. Comment est-ce que cette réflexion est mise en acte dans la circulation des textes et leur mouvement au sein du travail collectif que vous déployez ? Concrètement, comment se pensent ces collaborations ?
Floriane: Très concrètement, j’ai l’impression qu’il y a plusieurs niveaux, il y ce que le travail de création implique intimement, avec la mise en pensée, en risque et en acte que produit l’oeuvre sur soi-même et en soi-même, c’est-à-dire comment elle agit en nous et nous modifie, nous fait grandir. C’est-à-dire, par son contact, il y a un effet de catharsis. Et ensuite, il y a dans la pratique, là encore très concrètement, penser la collaboration dans une forme d’hospitalité de ce que chacun, chacune a à nous révéler de l'œuvre avec son regard, sa voix, son interprétation qui la différencie d’une autre. Le spectacle Vieille Petite Fille a connu deux distributions, une première lors de la création au festival Lynceus avec Edith Proust, Laure Blatter et Anthony Audoux puis ensuite, celle actuelle, avec Juliette Séjourné, India De Almeida et Anthony Audoux. Ces deux distributions participent aux deux vies de ce spectacle où il n’y pas d’interchangeabilité mais une multiplicité de lectures et de résonances, à titre d’exemple, un même rôle travaillé dans le sens de l’excès pour masquer le vide de la perte dans le deuil, peut avoir une part totalement clownesque mise en relief ou une gravité sombre avec des éclats de rire. Il faut en un sens s’émanciper de ce qui a été déjà établi, c’est un peu le propre du théâtre vivant. Disons que la plasticité, c’est le présent, c’est le mouvement…
Juliette S.: C’est un lien d’amitié et de réflexion, et presque une forme de gémellité, qui a lancé notre collaboration avec Juliette, pour porter, à voix haute, les Lettres à Jean-Loup Rivière. Ce qui m’a fait « drôle », c’est d’être ainsi invitée à prendre toute cette place, d’interprète « soliste » ( si l’on peut dire) et d’interprète de ce texte si présent, si libre d’énoncer // je ne me sens pas libre d’énoncer a priori. Jouer est alors d’abord apprendre à oser dire des choses « deep » // expression qui revient souvent au sujet du texte, que je reprends maintenant. C’est un premier chemin d’émancipation. Un autre geste d’émancipation a lieu, il me semble, dans la liberté que nous prenons d’incarner différemment des Lettres : non plus « au plateau », mais sous forme de dispositif d’écoute. Quelque chose semblait plus juste, intuitivement, que ces textes soient réunis, incarnés, en un même lieu, mais de manière très différente.
Rodolphe : Il y a eu, tu le rappelles Floriane, plusieurs vies scéniques de ces textes. Comment ce travail se poursuit-il entre vous et s’inscrit-il dans un mouvement collectif ?
Juliette R.: J’ai vraiment rencontré Juliette Séjourné autour des Lettres à Jean-Loup Rivière, à l’occasion d’une carte blanche qui m’avait été donnée par Camille Plocki et Asja Nadjar pour le Festival Remue. Je crois que sans cette rencontre je n’aurais pas su ou pu monter ce texte. Il fallait une entente profonde et les infinies qualités d’interprétation de Juliette Séjourné pour que ce texte puisse exister scéniquement. Cela n’est pas un texte facile, loin de là, et il fallait une actrice qui ose se laisser traverser par la puissance des émotions dont témoignent ces lettres, sans jugement.
En pensant à Juliette Séjourné et à Floriane Comméléran, tout d’un coup m’apparaît la chance que sont ces rencontres, comme d’ailleurs Rodolphe Perez, grâce à qui ces textes sont devenus un livre. Peut-être que la chance n’est que la forme nécessaire de la rencontre lorsque ce que l’on porte ou met - ici dans un texte, mais j’imagine qu’il en va de même dans toute forme d’art - son corps en scène, sa vie en jeu. Ainsi Floriane Comméléran a-t-elle été sollicitée par le Festival Lyncéus pour monter Vieille Petite Fille. Grâce à elle le texte a été révélé à son premier public breton, a tourné en festivals jusqu’en Corse, et va exister en version « intérieur » pour la première fois ce mois de mai, avec une magnifique équipe au plateau. Et notre collaboration se poursuit sur un autre texte…
Floriane: On peut donc dire que la première vie scénique de Vieille Petite Fille date de ce moment-là, du Festival Lynceus, juin 2022, où sa première scène était littéralement un bord de mer et avait pour unique mur de scène : l’horizon. Une fois le texte écrit par Juliette, quelque mois avant le début du festival, Sébastien Depommier du collectif Lynceus m’a appelée pour me proposer de participer à ce festival de création contemporaine situé dans les Côtes d’Armor et dont la particularité (et le beauté) est de proposer des pièces écrites spécialement à cette occasion et autour d’un thème, « sauvage » cette année-là comme l’a dit Juliette. Les pièces sont par la suite jouées à ciel ouvert pour les habitants de la ville et les festivaliers et le choix de l’espace de jeu in situ revient aux metteurs en scène invité.es.
C’est donc là que j’ai reçu pour la première fois entre les mains la pièce Vieille Petite Fille de Juliette Riedler, à quelques mois du début du festival. Au départ, j’ignorais vraiment par quel bout prendre ce texte. C’était la première fois que je mettais en scène un texte que je n’avais pas choisi. Dans une toute autre mesure, c’est un peu comme à l’opéra, où le livret et la distribution constituent un déjà-là et il s’agit de composer avec ce déjà-là, ce qui relève aussi bien du pur hasard ou de la chance, mais comme m’a glissé Juliette un jour, le hasard est la forme cachée de notre désir, il y a quelque chose de très beau qui est à la fois en attente et à la fois de l’ordre de la rencontre où l’on s’aventure pas à pas dans une intimité qui n’est pas encore la nôtre mais qui va le devenir, en attente de le devenir. J’ai donc attendu avant d’imaginer quoique ce soit de ce texte et c’est vraiment la rencontre avec le lieu, là où il a été écrit, pas précisément mais dans son environnement, qu’il s’est produit quelque chose. C’est précisément lors de la visite des différents sites proposés par le festival que s’est faite instantanément la mise en scène, que le texte prenait vie dans ces paysages et où j’ai commencé à entrer dans cette intimité, à travers la ville, son phare, ses espaces de jeu et bien sûr la mer, à la fois lieu d’écriture et sujet homonymique de l’histoire puisqu’à travers la transmission matrilinéaire de la condition féminine dont il est question avec cette réécriture du Petit Chaperon, c’est à la mère qu’on s’adresse. L’espace d’origine de l’écriture est ce qui a ouvert l’horizon scénique. J’ai donc construit la mise en scène à partir des potentialités scéniques et imaginaires de trois lieux très différents les uns des autres, avec un principe de déambulation du public qui suivent les pas de Loup pour nous mener au lieu de la grand mère, le chemin de fille, se fait à l’abris de nos regards. Il y a donc une itinérance, du mouvement, des déplacements. Le dehors avec son absence de limites, a contrario de la salle de théâtre, a permis de matérialiser la trajectoire géographique et symbolique qu’effectue « Fille ». Et maintenant, ce principe déambulatoire constitue une forme d’invariant quelque soit les lieux. À partir de là, nous avons inclus des changements, adaptations à partir de chaque typologie de lieux (nous avons joué dans des lycées, jardins de musée pour la journée du Matrimoine, dans les hauteurs d’un petit village corse au Festival de l’Olmu…) et la seconde et toute nouvelle vie de Vieille Petite Fille arrive tout bientôt dans une version scénique inédite, pour la première fois en intérieur. Sans tout dévoiler, faire ce travail dans ce sens est assez intéressant, nous gardons notre principe d’invariant mais les limites spatiales de la salle de théâtre impliquent un déploiement imaginaire à partir de la matérialité des mots et des images dans un travail de resserrement de l’espace où l’on passe in fine du réel à l’imaginaire. Cela renforce en un sens la dimension de rituel à l’intérieur de la pièce et condense l’exercice de l’interprétation. L’équipe s’est aussi agrandie avec un créateur lumière Rudy Sanguino et une scénographe Cecilia Galli.
Rodolphe : qu’est-ce qui circule de ce texte ? Ou plus précisément, comment on emprunte à la contemporaine immédiate un texte pour le subjectiver ? autrement dit encore Juliette S. et Floriane : comment ici, aussi en général dans vos pratiques, un texte vous parle au point de vouloir lui donner une forme ? et comment se joue, Juliette R., cette plasticité d’une écriture si proche ?
Floriane: C’est assez particulier je dirai parce que cela passe avant tout par la langue, l’écriture et quoi de plus personnel que la langue ou l’écriture. Comment on subjective la langue d’un ou d’une autre, au-delà de ce qu’elle contient en récits ? Et pourtant c’est ce qui se produit continuellement, que ce soit pour un tableau ou un livre, il y a toujours un échange secret de subjectivités parallèles. Le texte circule en nous parce qu’il a une voix et qu’il vient nous parler mais si on n’y ajoute pas d’autres voix, les nôtres en l'occurrence, paradoxalement il reste inaudible. Donc, on va le subjectiver petit à petit, par petites touches, d’intuitions en intuitions, de résonances en résonances, en y ajoutant des détails qui viennent se poser comme des révélateurs d’histoires, on y ajoute des références personnelles ou des lectures-échos. Le livre de Claire Marin Être à sa place est venu, par exemple, se glisser dans nos références communes sur la nécessité parfois de scier les branches de son arbre généalogique pour ne pas reproduire certains patterns. Et puis ce que Juliette R a fait de se risquer à subjectiver et démasquer le conte du Petit Chaperon rouge, nous nous y sommes aussi risqués avec des questions toutes simples telles que par exemple : de quoi le rouge est-il le nom ? Pourquoi se sont nos mères qui nous habillent ? Qu’est ce qui se transmet de mère à fille, de grand-mère à fille ? « Peut-on aimer sans se réduire ? » etc. etc. Déchiffrer, subjectiver, composer et interpréter en quelque sorte… Et de manière plus générale, un texte me parle au point de vouloir lui donner forme parce que je devine qu’à son contact, il y aura une forme de transformation sans savoir d’avance ce qu’elle sera.
Juliette S.: C’est très intuitif. C’est ce texte, c’est le contexte qui se profile pour l’incarner, avec l’autre texte. C’est le souvenir de l’interprétation des Lettres à Jean-Loup Rivière et de Vieille Petite Fille. C’est l’amitié de Juliette, qui fait que j’ose aussi énoncer un ressenti quant à la forme que pourrait prendre l’incarnation d’un texte à côté d’un autre. C’est aussi une forme de « délicatesse » vis-à-vis des spectateurs et spectatrices que j’ai écouté suite aux différentes interprétations.
Juliette R.: Comme je le disais plus haut, ces textes sont écrits dans des moments et contextes très différents. Ce sont deux types d’écriture avec les mêmes obsessions, sans doute. En fait, c’est en voyant Juliette S. interpréter Fille dans Vieille Petite Fille, après que nous ayons passé un certain nombre d’heures à travailler sur l’interprétation des Lettres que je me rends compte des circulations communes, de la continuité et des sauts qui caractérisent ces deux textes.
Rodolphe : D’où est venue l’idée de ne pas proposer une mise en scène des Lettres, qui ont déjà eu des versions scéniques et interprétées par Juliette Séjourné ?
Juliette R.: En réalité, Juliette S. et moi avons déposé quelques dossiers et candidaté à quelques résidences pour développer le projet, mais il semble qu’il ne soit pas très « vendeur ». Comme je n’ai pas de compagnie et voyais bien qu’il y avait un risque d’épuisement à aller toquer de portes en portes, nous avons fait le choix de laisser les choses venir et de se « tenir prêtes » (the readiness is all, dit Hamlet !) et disponibles à ce qui se présente. Nous avons d’abord pensé donner des lectures des Lettres au long des représentations de Vieille Petite Fille aux 3T, mais d’une part, c’était pas mal de contraintes techniques et notamment la création d’une billetterie parallèle, d’autre part et surtout, nous pensons que les deux textes sont chacun de « gros morceaux », et qu’il ne fallait pas surcharger le public dans sa réception. De là est née, ainsi que du savoir-faire et des tropismes de Juliette Séjourné, l’envie de réfléchir à un format plus « léger » dans son accès, et « libre ». Nous sommes finalement arrivées à cette idée des qr codes brodés. Dans cette entreprise, et puisque tu parlais de collectif juste plus haut, Frédéric Bevilacqua, chercheur à l’Ircam, fut d’une aide infiniment précieuse. Sans lui nous n’aurions pu enregistrer ces Lettres dans de si bonnes conditions. De même Pierre Nouvel, scénographe, nous a éclairées de son regard artistique et soutenues par son appui technique.
Rodolphe : L’idée de la broderie est symboliquement forte parce qu’elle participe de ce tissage d’un fil commun. De même, bien qu’il construise un médium vers l’immatériel, votre geste de tissage matérialise le qr code, qui n’est pas un objet mais une surface plane. Je crois que la réflexion sur le relief du support n’est pas anodine, d’autant plus qu’elle est, là encore, construite ensemble.
Juliette R.: Oui, d’autant que « texte » et « tissu » « délicatesse » ou « tissage » ont la même étymologie… Il était hors de question pour moi de faire intervenir un qr code brut, comme si on allait commander quelque chose au restaurant… mais vraiment, puisque nous cherchions la légèreté du dispositif (sans casques, câbles ou matériel audio laissés sur place) de traverser l’élément technique (le qr code) avec un savoir-faire typiquement féminin et aussi largement méprisé pour cela : le point de croix. Juliette S. m’a transmis son savoir-faire en la matière, il est donc aussi question de transmission mais en ce cas elle est positive, consciente et en vue de créer un objet, lui-même vecteur pour l’écoute d’une voix, celle de Juliette S. portant mes mots. Tout cela a lieu sans aucun geste spécifique demandé au public, seulement un brin d’esprit d’enquête et de curiosité, partant du prérequis que tout le monde est équipé d’un téléphone avec appareil photo et connexion internet. Le texte (re)devient tissu et forme permettant d’accéder à sa lecture. On peut l’emporter avec soi pour l’écouter ou prolonger son écoute plus tard…
DISTRIBUTION
Texte Juliette Riedler, édité aux Éditions Tango Girafe
Mise en scène Floriane Comméléran
Décors Cecilia Galli Avec Anthony Audoux, India de Almeida, Juliette Séjourné & la voix d’Edith Proust
Musique Antoine Françoise
Lumières Rudy Sanguino
Administrateur de production Quentin Pageot
Production et soutien
Production Compagnie Alphageste
Coproduction Festival Lynceus
Avec le soutien de département de l’Orne